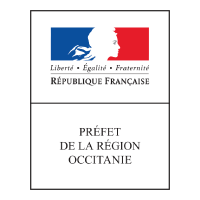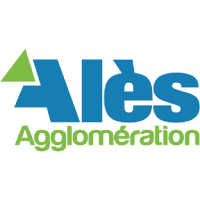Philosophe allemand de renommée, Walter Benjamin est davantage connu pour ses traductions, ses critiques et ses flâneries plus que pour son amour des contes.
Pourtant, il a dédié un ouvrage au processus de la narration, qui est parfois traduit avec le terme qui renvoie à ce genre de la littérature orale : « Le conteur ».
L’art de raconter des histoires est toujours l’art de reprendre celles qu’on a entendues, et celui-ci se perd, dès lors que les histoires ne sont plus conservées en mémoire. Il se perd, parce qu’on ne file plus et qu’on ne tisse plus en les écoutant. Plus l’auditeur s’oublie lui- même, plus les mots qu’il entend s’inscrivent profondément en lui. Lorsque le rythme du travail l’occupe tout entier, il prête l’oreille aux histoires de telle façon que lui échoit naturellement le don de les raconter à son tour. Ainsi donc se noue le filet où repose le don de raconter. Il se défait aujourd’hui par tous les bouts, après qu’il ait été assemblé, voici plusieurs milliers d’années, dans la sphère des plus anciennes formes d’artisanat.
Source :
Abstract: Comment transmettre le passé ? Est-ce possible dans un monde régi par l'information brute et l'immédiateté ? Les trois célèbres textes réunis ici - La tâche du traducteur (1923), Expérience et pauvreté (1933), Le conteur (1936) - sont traversés par cette idée : depuis la Première Guerre mondiale, l'expérience a perdu de sa valeur, ce que l'on a soi-même vécu n'est quasiment plus mis en mots et transmis d'une génération à l'autre. Benjamin livre ici une poignante réflexion sur la beauté de ce qui disparaît, le sens de l'histoire et notre attitude ambiguë vis-à-vis du passé.