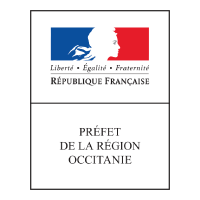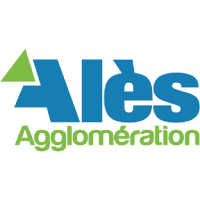Rencontres d’Automne du CMLO 2008 : Les fonctions éducatives de la littérature orale
Comme chaque année, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale organise, en septembre, une rencontre autour d’un thème concernant la littérature orale.
La littérature orale traditionnelle, au-delà du plaisir de l’écoute, se révèle être un moyen efficace pour l’éducation de l’ensemble des sociétés humaines. Au cours de ces rencontres, nous tenterons de comprendre les raisons de cette universalité et surtout les limites et les spécificités éducatives de ces formes narratives.
Au-delà du cadre général, au cours d’une journée de préparation, nous avons choisi de développer trois champs spécifiques faisant écho aux problématiques de l’ »Education Nationale » :
– La littérature orale et la maîtrise de la langue
– La littérature orale et l’interculturalité
– La littérature orale et l’éducation spécialisée
Seront présents pour étayer notre recherche:
– Nadine Decourt : docteur en littérature comparée et en anthropologie, membre du CREA, enseignant-chercheur (IUFM/Faculté d’Anthropologie, Université de Lyon)
Auteur de « Contes et diversité des cultures » avec M. Raynaud, CRDP Académie de Lyon
– Christian Montelle : professeur de français retraité, a étudié et pratiqué la poésie, le théâtre et les textes oraux de la tradition, tout au long de sa carrière au Maroc, pendant dix ans, puis en Franche-Comté
Auteur de « La parole contre l’échec scolaire », Ed. L’Harmattan
– Henri Cazaux : conteur et instituteur spécialisé. Il encadre des ateliers sur la maîtrise de la langue orale auprès d’enfants ayant des difficultés scolaires
Auteur de « Conter à l’école », Cahiers pédagogiques n°304-305 (Paris)
Samedi 27
9h30 : Accueil
10h : Introduction des Rencontres
10h30 : « Le cadre anthropologique des systèmes éducatifs dans les sociétés de tradition orale » par Marc Aubaret
11h15 : Débat
11h30 : Le service éducatif du CMLO
12h : Débat
14h30 : « Littérature orale et éducation dans un cadre interculturel » par Nadine Decourt
15h30 : Débat
16h : « La littérature orale et la maîtrise de la langue » par Christian Montelle
17h : Débat
17h30 : Fin de la première journée des rencontres
20h30 : Scène ouverte
Dimanche 28
9h30 : Accueil
10h : Expériences diverses de projets éducatifs en relation avec la littérature orale
11h : Débat
14h : « La littérature orale en situation d’éducation spécialisée » par Henri Cazaux
15h : Débat
17h : Conclusion
17h30 : Fin des 5èmes Rencontres