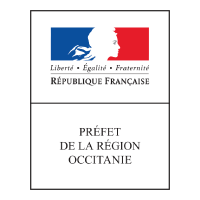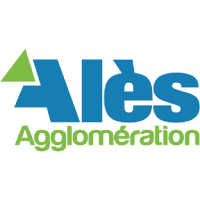Illettrisme
Des mots dits aux mots lus
Conter c’est déjà un peu lire et écrire !
La littérature orale a toujours été une forme d’oralité spécifique. Elle n’est pas seulement une parole pragmatique, mais développe une langue riche de formes poétiques, de structures narratives, de jeux de métaphores, d’une richesse de vocabulaire, d’applications grammaticales… Toutes ces expériences des langues sont des plus variées.
Les personnes en situation d’illettrisme sont, bien souvent, des personnes ayant eu une scolarité plus ou moins chaotique, où les règles de langage n’étaient utilisées qu’en tant que lois ne faisant pas sens. Ces personnes n’ont pas, le plus souvent, développé de compétence métalangagière.
Beaucoup de personnes illettrées (et pas analphabètes) ont oublié les quelques acquis d’écriture car les règles qui régissent cet ensemble de codes n’étaient pas claires pour eux. La ponctuation, l’emploi des temps, les accords… n’étaient qu’abstraction. Si l’on considère les points communs de la création en littérature et en orature, on s’aperçoit que l’on peut envisager une conscientisation des règles de langage par des exercices strictement oraux.
Ou, comment le travail oral du conteur peut nous aider à mieux maîtriser et comprendre la langue. Le mot conte associé à la lutte contre l’illettrisme peut parfois interroger. Comment un récit émanant d’une production orale peut-il apporter quelque chose à la capacité d’écrire ou de lire?
Pourtant, si ces deux objets sont différents, ils partagent aussi de nombreuses ressemblances. C’est par la conscientisation de ces ressemblances que les récits de « littérature orale » peuvent aider à résorber une part des difficultés de lecture ou d’écriture.
Entre les pratiques orales et écrites du langage, entre parler, lire ou écrire, il existe bien sûr des différences : les matériaux signifiants, les systèmes linguistiques, les usages sociaux dans lesquels chacune de ces pratiques s’actualise, sont assurément distincts. Pourtant écrit ou oral, il s’agit avant tout de langage : parler, lire et écrire sont des activités langagières.
La langue orale est souvent considérée comme une forme d’expression qui s’acquiert sans effort, sans apprentissage. Bien entendu, tout enfant baignant depuis sa plus tendre enfance dans un bain linguistique va acquérir une capacité de langage oral. Mais de quelle langue orale parlons-nous?
La langue acquise dans la simple relation à son environnement linguistique est avant tout une langue d’expression immédiate qui n’a pas de volonté à faire œuvre ni à être reproduite. Elle se limite la plupart du temps à témoigner des expériences vécues, des incidents et des bonheurs de tous les jours, des angoisses et des désirs….. et son fonctionnement n’est que rarement analysé par celui qui la pratique.
Toute cette oralité même si elle n’est pas à négliger dans l’acquisition de la langue n’est pas celle du conte et n’a que peu à voir avec l’art du conteur.
Dans la tradition, le conteur même s’il est analphabète est un « écrivain de la bouche » et un « lecteur de paroles », car le récit qu’il s’est engagé à partiellement recréer et à transmettre constitue une œuvre patrimoniale qu’il doit comprendre et respecter.
Ce qui implique, dans une démarche totalement orale de réaliser une création en Orature proche de celle d’un écrivain.
Des utilisations pratiques et des réflexions théoriques
Dans le cas de l’illettrisme, comme pour beaucoup d’autres applications de la littérature orale, il est important aux yeux du CMLO de mener à la fois une réflexion théorique — basée sur les travaux des scientifiques qui ont réfléchi au sujet et mené des enquêtes capables d’interroger l’apprentissage, l’écriture, la reproduction sociale en milieu scolaire — à des outils qui découlent d’une pratique sur le terrain.
Quand comprendre, c’est déjà lire
Dans le comprendre, il y a un élément essentiel de la lecture. La part sémantique du récit oral est dépendante du vocabulaire utilisé. Sa syntaxe, la forme même de son expression, de sa ponctuation, de sa couleur, de sa musicalité sont autant d’éléments de sa composition. Même si cette lecture ne s’appuie pas sur des signes alphabétiques, elle nécessite un acte intellectuel proche de celui de la lecture …. Ces récits ne s’expriment pas de la même façon dans la forme orale que dans la forme écrite mais ils sont tout autant au service de « la création d’une œuvre » et contribuent à créer du sens commun, de la mémoire commune à laisser trace dans un ensemble social.
L’art spécifique du conteur dans l’apprentissage de l’écriture
C’est sûrement dans la façon même de travailler du conteur que se trouvent les éléments les plus intéressants permettant de comprendre à la fois certains processus de création littéraire, mais aussi la puissance de la langue et la spécificité de l’écriture.
En pratique et en écriture
La pratique de cet art du conte permet surtout de donner du sens aux règles de langage que beaucoup de personnes illettrées n’ont souvent conçu qu’au travers de « lois grammaticales » non fondées dans le sens. Un des atouts majeurs de ce travail est le passage à l’acte. Le fait d’avoir reçu une simple trame, une forme sans réel contenu, de l’avoir nourri, lui avoir donné chair et de la porter physiquement face à un auditoire permet de bien comprendre l’importance de la langue, les limites de son efficacité et surtout que toute parole n’est pas littéraire.
Pour aller plus loin
Écoutez la conférence « Littérature orale et lutte contre l’illettrisme » par Marc Aubaret (2010, Alès)
L’oral et l’écrit sont, dans nos sociétés occidentales, les deux modes d’expression de la langue. Dans beaucoup de sociétés, seul l’oral existe. Si une seule part de cette expression est enseignée, on se prive d’une immense richesse et l’on prend surtout le risque de ne rendre intelligible qu’une moitié du fonctionnement de la langue. Au cours de cette conférence, nous témoignerons de nos recherches sur cette relation entre oral et écrit et nous expliciterons nos méthodes d’intervention dans le champ de la lutte contre l’illettrisme.