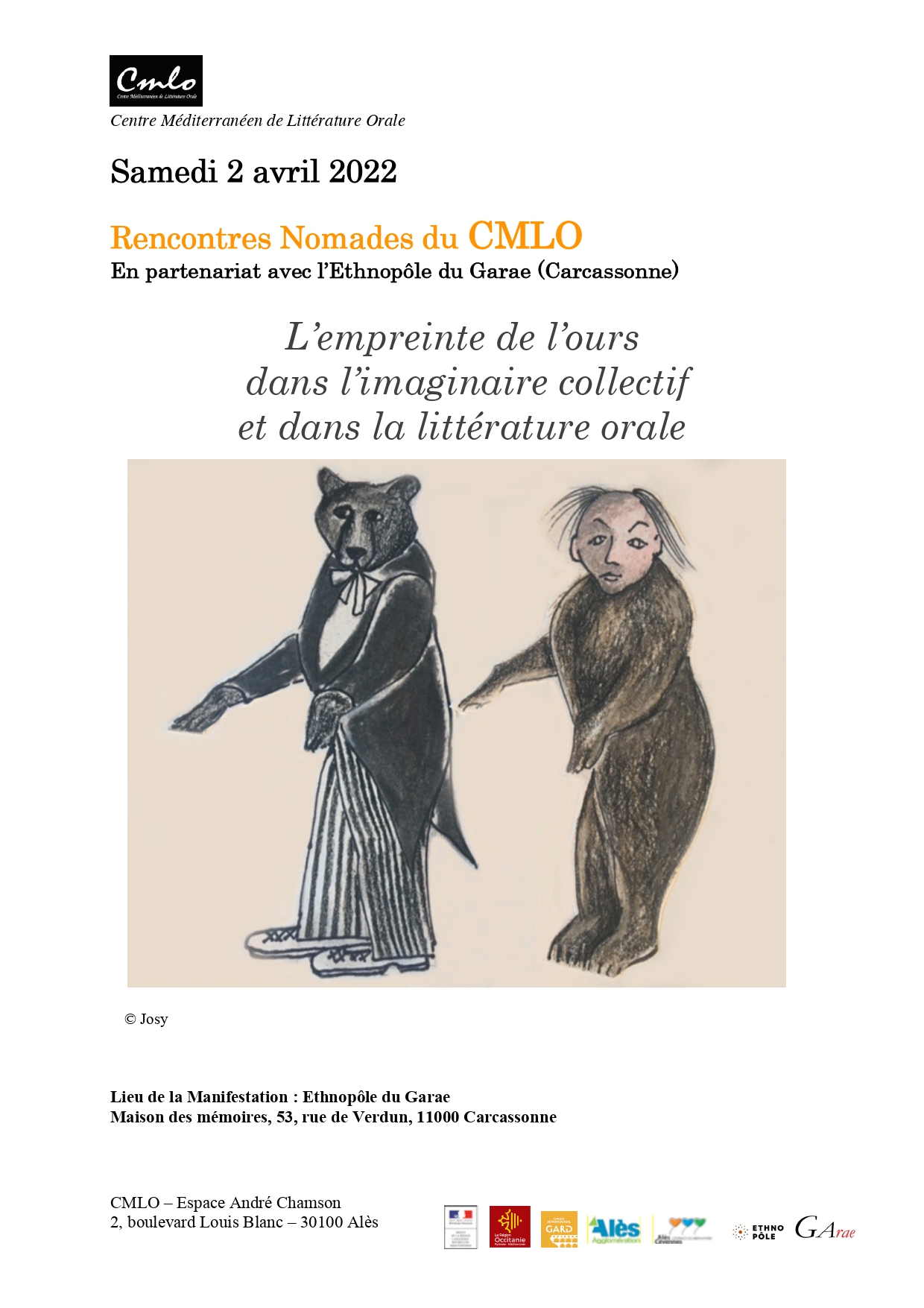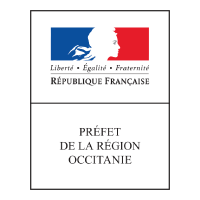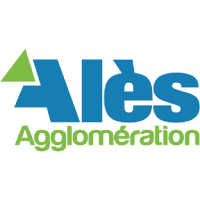L’empreinte de l’ours dans l’imaginaire collectif et la littérature orale
En 2022, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO), en partenariat avec l’Ethnopôle du Garae (Carcassonne) organise à Carcassonne les 2èmes Rencontres Nomades du CMLO le 2 avril 2022. Notre objectif au cours de ces rencontres est d’amener une réflexion sur les représentations de l’ours dans le patrimoine culturel immatériel au niveau régional, national et international.
L’ours dans les représentations de la littérature orale : des réflexions pour des enjeux environnementaux complexes
De l’Occitanie à la Sibérie, vénéré ou diabolisé, l’ours laisse son empreinte. Il a sillonné le sol depuis presque toujours dans le patrimoine culturel immatériel de multiples territoires et sociétés.
De peluche protectrice à prédateur de bétail, la figure de l’ours, dans ses multiples déclinaisons, imprègne l’imaginaire collectif et la littérature orale. La réintroduction des ours dans les Pyrénées a fait émerger des fractures sociétales qui vont bien au-delà de l’animal en lui-même. Il ne s’agit pas ici de se positionner dans une querelle dont certains éléments nous échappent encore mais d’analyser une figure multiforme et récurrente qui se décline selon les contextes et les périodes sous des représentations positives ou négatives.
L’ours dans les représentations de la littérature orale : des réflexions pour des enjeux environnementaux complexes
« Jean de l’ours aujourd’hui approche des diverses études, et appropriations par des artistes et des praticiens du thème de Jean de l’ours. »
Marc Aubaret, ethnologue spécialiste de la littérature orale et fondateur du CMLO
Au cours de son intervention, Marc Aubaret se propose de faire un point sur les études et les multiples transmissions de « Jean de l’ours ». Il analyse les interrelations entre les disciplines scientifiques, les procédés artistiques et les diverses pratiques (pédagogiques, psychologiques…) qui s’emparent de cette figure. A partir de cette recherche, il émettra quelques hypothèses sur ce que ce récit dit de notre société d’aujourd’hui.
Alain Rouch, responsable associatif (Institut d’Esudis Occitans), conteur, écrivain, chroniqueur (presse écrite et radio), narrateur (Grop Òc)
L’intervention se propose de faire un tour d’horizon des réalisations artistiques (littéraires, éditoriales, chansons,… ) et autres (économiques, touristiques,…) exprimées en occitan ou sur le territoire occitan (territoire linguistique et non celui de la petite région) mettant en avant non seulement le personnage de Joan de l’Ors/Jean de l’Ours, mais aussi plus généralement de l’ours, à la fois source de référence bienveillante et enfantine (Nounours), de question de transmission (mémoire populaire), d’enjeux écologiques (biodiversité) mais aussi élément de conflit (oppositions pastorales).
Ces questions ont été abordées par les diverses publications du conte, ses adaptations, des mises en scène, des airs populaires, des chansons rapprochant la défense de l’ours de la défense de la langue et du pays, jouant sur l’image d’« homme sauvage » de l’animal, version la plus répandue, même si minoritairement des positions contraires sont avancées.
L’ours, sera ainsi envisagé entre le Un còp èra… de références nostalgiques au passé et le Un còp serà…d’un autre rapport possible avec la nature et avec les animaux.
Elisabeta-Maria Maïlat, anthropologue, écrivain (auteur de nombreux livres publiés en France et ailleurs), réalisatrice de films documentaires, directrice d’ARTEFA (artefa05@gmail.com) est originaire de Transylvanie.
Elisabeta-Maria Maïlat vous propose un itinéraire trans-disciplinaire et transculturel suivant l’ours dans les Pyrénées, les Alpes et les Carpates, ce qu’elle appelle le Grand Parler réunissant trois sortes de traces : I. Si l’ours nous était conté ? Mise en récit des contes, rencontres, traditions, pratiques et images glanés au fil des années en France, Roumanie, Slovénie et Hongrie. II. Et si l’ours nous oblige à penser autrement ? Éclairer nos idées et expériences en résonance avec le peuple des Ursidés. III. Quels changements à venir avec l’ours ? Mise en perspective de l’anthropocène confronté au changement.
Olessia Koudriavtseva-Velmans, Docteur en esthétique, historienne et théoricienne de l’art diplômée de l’Université Paris Ouest
La Russie étendue sur un vaste territoire de l’Eurasie est un pays, qui dans l’imaginaire collectif s’associe souvent à l’ours. Depuis le XVIIIe siècle, les caricatures occidentales représentent l’Empire russe sous les traits de l’animal. Les représentations politiques peu flatteuses et en même temps inscrites quelque part dans l’inconscient commun, sont les représentations poly-sémantiques et hybrides, elles semblent trouver un écho jusqu’au nom de l’héritier de l’Empire Russe qui fut l’URSS. L’État communiste joue le jeu et choisit l’ours pour emblème des premiers jeux olympiques qui se sont tenus sur son territoire, réveillant ainsi la mémoire totémique du pays. La majorité de quelques deux cents peuples établis en Russie européenne et en Sibérie, garde dans ses cultures orales et matérielles, les traces des différents cultes de l’ours, qui précèdent largement l’apparition des monothéismes contemporains.
« Peau d’ours » conte et réflexions du travail du conteur sur les symboles
Claire Chevalier, conteuse et formatrice CMLO
Un conte de Grimm accompagné de Lyre.
Un jeune homme rescapé de guerre est dans la misère. Après un accord avec le diable, il va marcher pendant 7 années recouvert d’une peau d’ours. S’il réussit l’épreuve de ne jamais retirer cette peau, ni se laver, ni se couper les cheveux, il aura gagné et ne manquera plus jamais de rien…
Claire Chevalier présentera ensuite pourquoi elle a choisi de raconter ce conte et de le transmettre. Elle évoquera ensuite son travail de conteuse et « comment nous sommes un peu, nous conteurs, les « réceptacles » intuitifs de symboles très anciens et puissants » tout en s’appuyant sur la figure de l’ours.
L’ours dans les cultures autochtones de l’Amérique du Nord (en visio depuis le Québec)
Claude Hamel, conteuse et réalisatrice de documentaires
L’ours occupe une place centrale dans les contes et les légendes des autochtones de l’Amérique du nord. Sa présence en tant qu’animal totem des Eeyous (Cris) de Waswanipî est au cœur de la présence bienveillante qui accompagne l’être tout au long de sa vie. L’artiste québécoise Claude Hamel vous fera part de la forme particulière que ce totem protecteur revêt chez une artiste Eeyou qui en a fait le centre de sa pratique artistique. Elle présentera également quelques contes et légendes issus des cultures du centre de l’Amérique du Nord.
Pour aller plus loin
Abstract: Le 29 août 1869, lors de l'assemblée générale extraordinaire du Club Alpin Italien, à Varallo, dans le Valsesia, l'abbé Aimé Gorret, concluait, après avoir rappelé, dans son préambule, les mérites des alpinistes dans le domaine de la recherche scientifique, en géologie et en botanique tout particulièrement : «Il nous reste à étudier les détails des vallées, les mœurs, les habitudes, les traditions, les besoins et les préjugés des peuples ; il nous reste à saisir les traces des monuments et des civilisations passées ; il nous reste à reconstituer l'histoire intime des vallées ;... ». Né dans le Valtournenche en 1836, l'abbé Gorret n'a que 33 ans, mais il jouit déjà d'un grand prestige dans le milieux des alpinistes (il réussit le versant valdôtain du Cervin deux jours après la tragique ascension de Whymper). Ayant manifesté une intelligence précoce, au prix de grands sacrifices, il avait été envoyé, comme c'était à l'époque le cas pour quelques enfants valdôtains jusqu'à une époque récente, àAoste, étudier au séminaire pour devenir prêtre. Il le sera, mais il restera avant tout un paysan et un montagnard. Un montagnard qui a vu passer des «messieurs», des Anglais surtout, qui prétendaient escalader ses montagnes, pour une ambition alors inconnue aux montagnards, ou pour étudier des roches et des plantes que même les vaches ne mangeaient pas. Le montagnard était alors invisible aux yeux des premiers alpinistes qui le considéraient insignifiant, face à la beauté de la nature et à la grandeur de leur défi lancé aux cimes inviolées. Ainsi, l'abbé Gorret, à la première occasion, lance son défi à ces alpinistes, les invitant à découvrir aussi les montagnards. En parcourant les pages de la revue du CAI, il ne semble pas que l'invitation de Gorret ait été suivie, malgré l'exemple des comptes rendus d'excursions et d'escalades rédigés par Gorret lui-même, qui à chaque occasion, parlent des hommes, de leur travail et de leurs traditions. Mais la graine a été semée, et périodiquement, l'idée de Gorret sera reprise et relancée, quoique bien rarement citée, par d'autres alpinistes éminents. Pris par d'autres engagements et problèmes, Aimé Gorret ne pourra jamais s'adonner entièrement à la recherche qu'il suggérait aux autres. Mais ses témoignages, insérés comme des parenthèses dans ses écrits de montagne, restent les premiers dont nous disposons pour la Vallée d'Aoste et, dans certains cas, les seuls. On peut dire que l'abbé Gorret a déblayé la route aux premiers folkloristes valdôtains de la fin du XIXe siècle : Tancrède Tibaldi, Joseph-Siméon Favre et Jean-Jacques Christillin. primi folkloristi del XIX° secolo : Tancrède Tibaldi, Joseph-Siméon Favre et Jean-Jacques Christillin...
Abstract: Si l'ours et le loup occupent une place prééminente dans l'imaginaire occidental, c'est d'abord pour des raisons écologiques. Il n'y a pas si longtemps que ces deux grands prédateurs ont cessé de hanter les campagnes, menacer les pèlerins et porter atteinte, selon la croyance, à la vertu des femmes égarées dans les bois. Plus mystérieuse, en revanche, est la fréquence avec laquelle ces deux animaux sont évoqués côte à côte, voire l'un par rapport à l'autre. Que ce soit dans les bestiaires anciens, dans les sources folkloriques, dans les témoignages des derniers bergers ou encore dans le discours des éthologues et des militants de la cause environnementaliste, les stéréotypes de l'ours amant et du loup dévorateur reviennent de manière symptomatique. Pourquoi une telle permanence ? À la suite d'une analyse textuelle et ethnographique détaillée, SOPHIE BOBBÉ formule une hypothèse d'ordre psychanalytique : si ce binôme animalier semble si efficace, c'est par sa capacité à symboliser deux types univoques de rapport au monde. S'exprimant par deux modes de consommation, cannibalique et sexuelle, les figures du loup et de l'ours emblématisent deux orientations dans la destinée de leurs " partenaires " et deux postures sociales : régression, incorporation, rupture de filiation pour le loup versus évolution, échanges, reproduction pour l'ours. Supports projectifs particulièrement efficaces, ours et loup permettent, dans le langage figuré qui est le leur, d'assurer le lien entre le collectif et l'individuel et d'énoncer les normes sociales et leurs possibles transgressions : une tâche éminemment anthropologique.
Abstract: Découvrez et achetez Etudes mongoles et sibériennes, n°11, 1980, L'o... - Collectif - Centre d'études mongoles et sibériennes sur www.leslibraires.fr
Abstract: Lors de cet entretien, Roberte Hamayon revient sur ses travaux de recherche consacrés au chamanisme des peuples autochtones de Mongolie et de Sibérie. Anthropologue, elle s’est d’abord consacrée à l’étude de la langue mongole et à l’ethnographie de la vie quotidienne des Mongols et des Bouriates chez lesquels elle a effectué de nombreuses missions à partir de 1967. Peu à peu, elle s’est rendue également en Mongolie Intérieure (Chine). Dans ses travaux sur le chamanisme, thème qui va devenir l’objet principal de ses recherches, elle a été amenée à approfondir, entre autres, les notions d’épopée, d’imaginaire de la chasse et de jeux rituels. Plus récemment, elle a travaillé sur les recompositions identitaires en contexte post-communiste ainsi que sur la notion de « chance » et la série sémantique à laquelle elle appartient, envisagée dans sa dimension politique et religieuse.Roberte Hamayon est docteur en linguistique et docteur ès Lettres et Sciences Humaines. D’abord chercheur au CNRS rattachée au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative de Paris-X, elle a été directeur d’études à l’EPHE - Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des Sciences religieuses) de 1974 à 2007, membre du GSRL - Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE, CNRS) depuis 2002.
Abstract: Cet article est le récit d’une rencontre entre un ours et une anthropologue au Kamtchatka. L’auteur revient sur cette expérience et sur les rêves qui ont précédé l’événement lorsqu’elle se trouvait sur son terrain chez les Even de la région d’Icha au Kamtchatka. En opérant un va-et-vient entre son premier terrain chez les Gwich’in d’Alaska et le présent terrain au Kamtchatka, elle pose la question de la distance critique de l’anthropologue et des relations énigmatiques qui la lient à ceux dont elle partage les existences.
Abstract: " J'ai relevé le défi, en travaillant essentiellement sur la tradition orale authentique, et le plus souvent possible inédite, je vous parle de l'ours dans l'ensemble de la France du folklore [.] non seulement dans les Pyrénées mais aussi dans des lieux plus inattendus Haut-Rhin, Sarte, Bouches-du Rhône, Vendée, Alpes, Finistère, Lande
Abstract: En 2020, trois ours sont morts dans les Pyrénées. Entre les demandes des associations environnementales de les remplacer et les institutions agricoles locales qui veulent abandonner le programme de réintroduction, l’État ne réagit pas. Un statu quo qui, vingt-cinq ans après les débuts du processus, met en lumière une politique ayant peu considéré les bergers. Trois ours ont trouvé la mort dans les montagnes pyrénéennes, en 2020. Dernier d’entre eux, ou plutôt dernière : Sarousse, une femelle tuée par un (...)